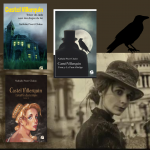Le dosage du suspense narratif.
Quand la 4e de couverture promet une intrigue palpitante, le lecteur s’attend à une bonne dose d’adrénaline. Il veut frissonner, haleter, tourner les pages comme on court après le souffle. Mais en tant qu’auteur, faut-il tout miser sur des sommets de tension dramatique ? Ou plutôt distiller le suspense avec finesse, jouer sur la lenteur, l’attente, les silences… comme un poison qui agit lentement ? Le suspense, c’est aussi une question de rythme. Un marathon où chaque pas compte ? Ou un sprint qui nous laisse exsangue mais exalté ?
En promettant une « intrigue palpitante », elle établit un pacte de lecture fondé sur l’attente d’émotions fortes, de rebondissements, de tension dramatique. C’est une promesse d’adrénaline, une incitation à plonger dans une expérience sensorielle intense. Mais cette promesse soulève une question essentielle pour l’auteur : doit-il répondre à cette attente par des effets spectaculaires ?
Répondre à cette promesse par des climax* explosifs (paroxysme), des twists* incessants (retournements de situation), des enchaînements d’actions peut sembler être la voie la plus directe pour captiver le lecteur. C’est le modèle du thriller hollywoodien, où chaque scène doit surpasser la précédente en intensité.
Cependant, cette approche comporte des risques : L’épuisement narratif : trop de rebondissements peuvent saturer l’attention du lecteur. La superficialité émotionnelle : l’action peut prendre le pas sur la profondeur des personnages. La prévisibilité : à force de vouloir surprendre, on finit par répéter des schémas attendus.
Face à cette logique du spectaculaire, certains auteurs choisissent une voie plus subtile : celle du suspense lent, de la tension psychologique, de l’attente maîtrisée. Ici, l’adrénaline ne vient pas d’un événement choc, mais d’un malaise qui s’installe, d’un doute qui grandit, d’un silence qui pèse. Et n’oublions l’épaisseur de nos personnages : la construction minutieuse des personnages participe à créer une atmosphère palpitante (le lecteur s’attache, s’inquiète, anticipe.)
Et vous, en tant que lecteur ou écrivain : vous préférez l’intensité fulgurante ou la tension qui s’installe et ne vous lâche plus ? Faisons un détour par les coulisses des maîtres du genre.
Je me souviens d’une série de lectures imposées à mes élèves ( Lycée René Cassin en Seine Saint Denis, au Raincy). Un peu de réticence au départ, bien sûr — les classiques du suspense ne séduisent pas toujours à la première page. Mais très vite, l’engouement a pris : les discussions s’animaient, les hypothèses fusaient, et les livres circulaient comme des trésors. Cinq auteurs : Stephen King, Patricia High Smith, Harlan Coben, Gyllian Flynn et Franck Thilliez. Dans la séquence précédente, nous nous étions concentrés sur des auteurs français du suspense et de l’étrange (dits classiques), tels que Gaston Leroux, Maurice Leblanc et Maurice Renard, dont les récits mêlent mystère, tension psychologique et fascination pour l’inconnu.
Et puis, sans qu’on sache vraiment comment, Stephen King s’est imposé. Naturellement, presque avec désinvolture. Il était partout : dans les sacs à dos, sur les bureaux, dans les conversations à voix basse entre deux cours et très vite sur nos écrans de télévision. L’auteur du moment, disait-on. Celui qui savait raconter la peur avec une élégance étrange, presque familière. Stephen King, le maître du suspense psychologique affirme dans On Writing que le suspense ne repose pas uniquement sur des rebondissements spectaculaires, mais sur la construction minutieuse de personnages et de situations. Pour lui, le lecteur doit se soucier profondément de ce qui arrive aux personnages avant que le danger ne survienne.
“Le suspense, c’est faire attendre le lecteur, mais avec une corde bien tendue entre ses mains.”
Mais n’oublions pas nos autres maîtres… le plaisir de lire, lui, reste bien vivant en classe, et nous poursuivons désormais notre exploration avec Patricia Highsmith.
Dans Plotting and Writing Suspense Fiction, Patricia Highsmith défend une approche lente et insidieuse du suspense. Elle préfère l’angoisse psychologique à l’action explosive, et recommande de faire monter la tension progressivement, comme une eau qui chauffe sans qu’on s’en rende compte.
“Le suspense ne doit pas crier. Il doit murmurer, puis hurler dans la tête du lecteur.”
Auteur de romans haletants comme Ne le dis à personne, Harlan Coben est partisan du rythme effréné, avec des twists et des climax réguliers. Il veut que le lecteur ne puisse pas poser le livre, quitte à sacrifier un peu de profondeur pour l’efficacité narrative.
“Chaque chapitre doit se terminer comme une porte qui claque derrière vous. Vous devez vouloir ouvrir la suivante.”
Gillian Flynn, cette auteure que j’adore, combine les deux approches : une tension psychologique lente, presque malsaine, avec des moments de bascule brutaux. Elle montre que le suspense peut être un jeu de manipulation, où le lecteur est complice malgré lui.
“Le vrai suspense, c’est quand le lecteur ne sait plus s’il doit croire ce qu’il lit.”
Pour notre auteur français Franck Thilliez, auteur de thrillers, la tension ne vient pas seulement des crimes ou des mystères, mais de la fragilité psychologique des personnages et de la précision chirurgicale avec laquelle il installe le malaise. Comme Stephen King, il sait que le lecteur doit ressentir avant de frémir. “Le lecteur aime se faire peur.” confiera-t-il un jour à un critique littéraire.
Alors que tout le monde se rue sur les auteurs de thrillers anglo-saxons, moi, je retourne tranquillement à mon ouvrage fétiche : Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, publié en 1907. Un roman d’énigme en chambre close, où la logique pure triomphe du spectaculaire. Et je souris en relisant cette phrase culte, énigmatique et poétique, qui ouvre les portes du mystère :
“Le presbytère n’a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.” Comme une incantation, elle me ramène à l’essence même du suspense : celui qui se glisse dans les interstices du réel, et qui fait frissonner sans jamais crier…
J’ai toujours cru que la lenteur n’était pas l’ennemie de l’excitation — mais son complice silencieux. Elle ne freine pas le souffle, elle le retient, juste assez pour que le frisson dure plus longtemps.
Nathalie Pivert-Chalon romans et littérature jeunesse
Le dernier baiser du papillon – 2021
Le pacte de nos mensonges – 2025
Saga Castel Villerquin (4 tomes) de 2018 à 2022, un cinquième titre en cours d’écriture.
Un récit en cours d’écriture, entre mystère, enquête et dérives du pouvoir…